 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |
Vous êtes ici :
|
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
|
|
FAQ : Bocage et qualité de l’eau ; |
|
|
1- Quel est le parcours de l’eau au niveau de la
haie ?
|
|
|
Le parcours de l’eau de pluie une fois au sol dépend des conditions de surface qu’elle rencontre, notamment du relief, du micro-relief et de la porosité du sol (obstacles opposant une résistance à l’écoulement de l’eau). En fonction de ces conditions l’eau s’écoule latéralement à la surface du sol ou pénètre verticalement dans le sol pour rejoindre éventuellement la nappe.
Trois points différencient la haie de la parcelle
cultivée.
Le sol n’est pas labouré, la végétation en place développe un système racinaire important qui favorise l’infiltration de l’eau dans le sol : dans l’horizon de surface (40 à 100 cm), la présence de racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur. L’horizon sous jacent (40-100 cm à 2 m) est souvent plus imperméable car il accumule les éléments fins lessivés. Il permet des écoulements latéraux et ralentis (schéma).
La végétation génère la production de litière.
La matière organique s’accumule au cours du temps et est assimilée dans le pool de matière organique du sol. La plus forte teneur locale en matière organique augmente la porosité du sol sous la haie, permet la rétention des éléments polluants et favorise le développement important de la microfaune du sol. En conséquence, plus une haie est ancienne, plus ces effets seront amplifiés. L’entretien de la haie favorise ou non cette production de matière organique (restitution ou exportation) ainsi que l’activité biologique (désherbage chimique).
Les racines de la strate herbacée sont très denses
en surface (0-40 cm), alors que celles issues des arbres se développent
aussi en profondeur (jusqu’à plusieurs mètres)1
et colonisent une épaisseur de sol plus importante. Les conséquences sur
le parcours de l’eau sont différentes. L’enracinement plus profond et
l’évapotranspiration (restitution d’eau dans l’air par la présence d’une
surface foliaire élevée) très forte des arbres2
augmente entraîne un assèchement local sous la haie qui augmentera,
selon l’emprise de la haie, les temps de transfert à l’automne vers la
rivière.
Remarque : un talus ou haie sans couvert herbacé du fait du passage répété des animaux (photos) entraîne une fragilisation de la structure de la haie :
- imperméabilisation de l’horizon superficiel ce qui limite l’infiltration de l’eau ; - déchaussement des arbres par érosion des sols, effondrement progressif du talus présent. Ces talus doivent donc être protégés et /ou réhabilités. Données extraites de :
C. Carnet, Premières données sur le rôle du bocage
sur la distribution des sols et la circulation de l’eau dans les sols,
Les bocages, Histoire, Ecologie, Economie, INRA, 1976.
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002 C. Drénou ,Les rôles secrets des racines et Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes, Forêt entreprise n° 153, 2003 |
|
|
2- Pourquoi augmenter le temps de
transfert de l’eau vers la rivière ?
|
|
|
Lorsque l’eau provenant du bassin versant atteint la rivière, sa
composition chimique est alors très peu modifiée au cours de son écoulement
dans le réseau hydrographique. Si l’eau est chargée en polluants, il faut
donc rallonger son temps de transfert, par des structures actives, avant
qu’elle n’atteigne la rivière pour que les mécanismes d’épuration puissent
se mettre en place. Pour les nitrates, ce sont :
- la dénitrification - l’absorption par les végétaux (cultures mais aussi arbres et arbustes des haies) Pour les produits phytosanitaires, ce sont : - la dégradation par la microfaune du sol - la rétention par le sol (matière organique). |
|
|
|
|
|
3- Les haies augmentent-elles la durée de transfert de l’eau vers la rivière ? Quels sont les facteurs primordiaux : la densité, la position des haies dans le versant ou leur orientation ? Bocage : à partir de quand il joue un rôle ?
|
|
|
On est aujourd’hui convaincu que les temps et les mécanismes de
transfert de l’eau en surface mais aussi plus en profondeur sont modifiés
et ralentis sur un bassin versant bocager (lié à la profondeur
d’enracinement des arbres et à leur évapotranspiration) par rapport à un
bassin versant non bocager. Ceci est particulièrement important en
Bretagne car l’eau transite essentiellement par le sol (plus de 95 % du
bilan annuel des précipitations, seulement 5 % de ruissellement).
Impact sur les flux de surface et le ruissellement
Par modélisation, on montre que la densité totale en haies3
n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface et que les
critères a retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la
pente, leur position dans le versant, leur connectivité.
- L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire
au versant) joue une rôle très important pour les écoulements de
surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle
mais aussi de tout un bassin versant. En effet les haies présentes en
travers de pente modifient le réseau de drainage (cf. schéma de Zhang) et
augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour
une épuration possible) en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol.
- La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente qui est importante à considérer plutôt que la densité de haies (bien que ces deux facteurs soient évidemment liés). Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter 40 % des eaux s’écoulant à la surface du sol d’un petit bassin versant et donc influer sur leur qualité. Impact sur les transferts de subsurface
La présence de bocage ralentit aussi les écoulements
dans les premiers mètres du sol (écoulements de subsurface) même
lorsqu’il est dégradé. En modélisant les flux d’eau sur des bassins
versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200
m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une
diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la
rivière selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de700
mm) : ainsi plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à
l’exutoire du bassin versant.
Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très importantes (1200 mm) mais existe toujours (plus que 18 % d’influence sur les débits à une densité 200 m/ha). La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un impact important. Par exemple, si 60 m/ha de haies sont situées en fond de vallée, ils réduiront de 10 % environ le débit à la rivière par rapport à une même densité située sur plateau. Importance du cumul annuel des pluies sur le rôle
hydrologique du bocage
Le rôle du bocage est très lié à sa capacité
d’évapotranspiration (ETR) Lorsque la pluie augmente, l’évapotranspiration
du bocage augmente aussi jusqu’à une certaine limite. Un seuil est atteint
lorsque les précipitations sont supérieures à 800-1000 mm environ.
Données extraites de V. Viaud , soutenance de thèse 2004. Flux de surface : résultats issus de la modélisation du % de la surface de bassin versant déconnecté à partir de 5 cas réels) Flux de subsurface : résultats issus de modélisation issus du module hydrologique de TNT2 appliqué à des maillages bocagers réels, avec des pluies réelles. Les haies sont modélisées par des mailles sur lesquelles on augmente l’ETM, la RFU et la profondeur de prélèvement / culture |
|
|
4- Quel est le rôle hydrologique d’un talus ?
|
|
|
Le talus constitue un obstacle physique à l’écoulement
de l’eau en surface, redirige son écoulement et favorise l’infiltration.
(schéma de Zhang).
Deux cas s’opposent : - S ‘il est situé parallèlement à la pente, le talus est un obstacle physique qui guide l’eau dans le sens de la pente (schéma). Si le sol est peu drainant et que la surface de la parcelle est importante, le flux d’eau peut être important et le talus est lors précédé d’un fossé qui permet de canaliser l’eau. - S’il est perpendiculaire à la pente (cas largement le plus étudié), le talus intercepte le flux d'eau. Si celui-ci est peu important, l’eau s’infiltre alors en profondeur. Si le flux d’eau est important ou que l’infiltrabilité du sol est faible, l’eau peut s’accumuler en surface et créer une zone de stagnation en surface préjudiciable lorsque le sol adjacent est cultivé.
Les situations intermédiaires existent qui
peuvent favoriser une accumulation d’eau localement (schéma).
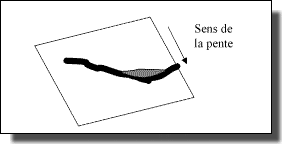 La plantation d’une bande enherbée peu alors être une
solution pour que l’eau s’infiltre progressivement et ne s’accumule pas.
Remarque : Hormis son rôle hydrologique, le talus constitue un obstacle physique à l’érosion des sols. Des études pédologiques à l’amont et l’aval des talus montrent l’épaississement important du sol en amont d’une haie perpendiculaire à la pente alors qu’une érosion du sol se produit généralement à l’aval. La différence de dénivelé peut parfois atteindre quelques mètres ce qui montre que l’érosion des sols est un phénomène observable en Bretagne et que le bocage limite cette érosion en la cantonnant à l’échelle de la parcelle. Il offre un gradient de conditions physico-chimiques propice à la biodiversité (alternance de conditions plus ou moins sèches et selon l’orientation par rapport au soleil, d’ombre et de lumière.
Données extraites de :
P. Merot, les haies en Bretagne, une solution d’avenir, La Revue Durable, numéro test, juin 2002 |
|
|
5- Faut-il boiser un talus ?
|
|
|
Le cas des talus de bas de versant est important à analyser ici. En effet, dans les fonds de vallée, la nappe affleure en surface pendant plusieurs mois. Les racines des arbres et le toit de la nappe sont proches pendant une partie importante de l’année, et il est aujourd’hui clair que les arbres plantés sur ces talus de bas fond absorbent une partie importante des nitrates présents dans la nappe et ont donc une influence forte sur la concentration en nitrate de la nappe puis de l’eau de rivière qu’elle alimente. De plus ces talus sont généralement disposés à la limite de sols hydromorphes et une forte dénitrification y a été mesurée. Boiser un talus dans ce cas est donc important pour augmenter l’épuration en nitrate de l’eau transitant dans ces zones. Enfin ces talus sont également situés en limites de champ d’expansion des crues et leur boisement permet vraisemblablement de jouer un rôle hydrologique en cas d’inondation.
Il est également possible que des mécanismes similaires se
produisent sur des talus situés plus en amont dans le versant. Cela
est vraisemblablement le cas pour les talus précédés d’un fossé où de l’eau
circule une partie de l’année.
Il y a également des avantages à boiser les talus placés
ailleurs dans le paysage. Les avantages d’un talus boisé sont les suivants :
- favoriser l’infiltration des eaux par la présence de racines qui se développent en profondeur, - dynamiser les biotransformations par la présence de matière organique peu humifiée, dans le sol sous la haie mais aussi le fossé s’il est présent et peu circulant, - stabiliser le talus (rôle structurant des racines), - renforcer un rôle de clôture, - augmenter la biodiversité (abri et nourriture pour la faune), Données extraites de :
V. Caubel, 2001. Influence de la haie de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate. Thèse, 156 p. IDF, 1995. « Les talus du bocage », C. Drénou, 2003. « Les rôles secrets des racines » et « Typologie et variations de l’enracinement des arbres adultes », Forêt entreprise n° 153 |
|
|
|
|
|
6- Quel est l’impact hydrologique d’une
haie à plat par rapport à un talus ?
|
|
|
Le rôle hydrologique d’une haie à plat a très peu été étudié en tant que tel car c’est souvent sur le talus boisé que se sont focalisées les recherches. Il est donc difficile d’évaluer séparément les rôles respectifs du talus et des plantations qui sont ancrées dessus.
Par analogie cependant, on peut mettre en relief plusieurs effets hydrologiques probables de la haie à plat. Le premier, déjà décrit plus haut est relatif aux caractéristiques du sol sous une haie. Espace non cultivé, le sol sous la haie est colonisé par les racines, riche en matières organiques et favorise donc l’infiltration de l’eau, la rétention et la dégradation des polluants. Dans ce cas, on peut penser qu’elle se comporte comme une bande enherbée améliorée en favorisant la sédimentation des particules et en diminuant donc le ruissellement et l’érosion des sols. Par rapport à une bande enherbée, une haie a une dimension pérenne, elle sera moins facilement labourée et devient donc un élément permanent et visuel du paysage.
|
|
|
1 Notons que la
profondeur d’enracinement des arbres est limitée par la hauteur de la
nappe phréatique et la profondeur du sol ce qui a de l’importance pour
les haies plantées en fond de vallée qui développeront alors un système
racinaire plus superficiel.
2 Notamment en été Les conditions d’éclairement, de turbulences de l’air, d’extension des racines, l’absence de concurrence avec d’autres arbres favorisent la transpiration des arbres par comparaison avec des arbres en forêt 3 la haie modélisée est une haie avec végétation arborée mature sur talus. |
|
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|