 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |
Vous êtes ici :
|
|
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
||
|
Délimitation cours d'eau |
||
| N. Carluer et C. Gascuel |
||
|
1- Une définition hydrologique du cours d'eau |
||
|
L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1).
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 (calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir d'une carte au 1/25 000ème. |
||
|
||
|
Figure 1 : Mode de calcul des
indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est
d’ordre 1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est
d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordres
différents prend l’ordre du bief le plus élevé.
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. |
||
|
||
|
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN |
||
|
L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité (sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème. |
||
|
|
||
|
Figure 2
: Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un
inventaire de terrain selon les ordres de Strahler. Cas du bassin versant
de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22
pour la communauté de commune de Matignon. |
||
|
De la même
façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au
1/25 000ème où le réseau hydrographique représente 85,2 km de
cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que celui
issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6
fois le linéaire de l’IGN (figure 3). |
||
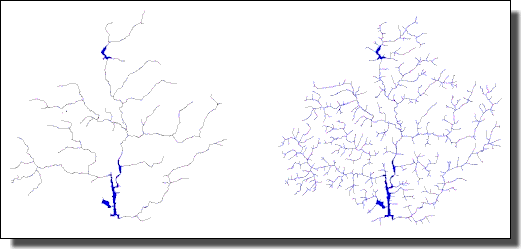
|
||
Figure 3 : Comparaison des linéaires
de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème
et sur le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude
réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat Mixte de Kerné Uhel. |
||
|
Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 et sera souvent peu modifiée par la suite. |
||
|
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau |
||
|
Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2.
Un travail important a été réalisé lors de
l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des cours d'eau.
La méthode de recensement des cours dans le cadre
des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet en plus de
l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de
l’eau et à terme une mise en place d’actions facilitée.
|
||
|
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) |
||
|
||
|
Adapté de « Guide d’orientation
méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la
Vilaine ». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur
www.eptb-vilaine.fr |
||
|
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) |
||
|
Dans ce
cadre, le réseau hydrographique est défini comme « le réseau circulant de
façon permanente au minimum pendant les trois mois de la période
hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel classé
intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du
réseau des fossés ». Une attention particulière doit également être portée
aux « fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui
permettent d’évacuer les eaux pluviales vers le réseau hydrographiques »
et aux « émissaires de drainage […] considéré comme fossés circulants ».
|
||
|
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) |
||
|
Elle repose sur un arbre de décision
hiérarchique (figure 4). |
||
|
||
Figure 4 :
Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours
d’eau. Extrait du site
www.csp.ecologie.gouv.fr |
||
|
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) |
||
|
Extrait de
« Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages.
La méthode de recensement des cours d’eau
repose sur trois clés d’entrée :
- ce qui relève du constat immédiat, - ce qui s’évalue dans le temps, - ce qui relève de la mémoire. - ce qui relève du constat immédiat
:
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). • La présence d’une berge définie comme « le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. • Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». • La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux) - ce qui s’évalue dans le temps :
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse (champ inondé, affleurement de nappe) • La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses - ce qui relève de la mémoire :
• Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). |
||
|
1 SAGE : Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2 participative : c’est à
dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire
|
||
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|