 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau . Produits phyto. . Nitrates . Phosphore . Mat. organique dissoute . Métaux lourds . Bactéries . Conclusion . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Voies de transfert . Infiltration . Ruissellement . Ecoulement de nappe . Vitesse de transfert . Temps de transfert . Conclusion . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau • Zones humides • Bandes enherbées • Bordures de champs • Analyse du paysage Liens |
Vous êtes ici :
|
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
|
|
Les voies de transfert : Circulations de l’eau et des polluants dans les bassins versants sur socle |
|
| J. Molénat, J.M. Dorioz, C. Gascuel et G. Gruau |
|
|
IV- Les écoulement de nappe |
|
Les écoulements dans la nappe
sont alimentés par les eaux de percolation (figure
3). Ils sont aussi nommés écoulements souterrains ou écoulements de base (sous entendu hors crue). L’écoulement de base n'intervient en effet que pour une faible part dans l'écoulement de crue à cause des faibles vitesses de l'eau dans le sous-sol. De plus, ils ne sont pas toujours reliés au même événement pluvieux que l'écoulement de surface : ils proviennent généralement des pluies antécédentes. Les écoulements de nappe assurent en général le débit des rivières en l'absence de précipitations et soutiennent les débits d'étiage (l'écoulement souterrain des régions karstiques fait exception à cette règle). En Bretagne, la nappe est relativement superficielle par rapport à d’autres régions françaises puisque son toit est au maximum distant de la surface d’une trentaine de mètres et plus souvent situé à quelques mètres, voire atteint la surface du sol en fond de vallée. Cela est lié à la structure et à la géologie du sous-sol breton, considéré comme peu perméable. |
|
|
1- Toit de la nappe et position topographique dans le bassin versant, écoulement de subsurface |
|
Dans certaines parties du bassin
versant, la nappe est proche de la surface. Ce sont : - les zones de bas de versant, à proximité des cours d'eau, où la nappe, suite aux précipitations d'automne sur l'ensemble du bassin versant, affleure en hiver. Tout le profil de sol est alors saturé " par le dessous ", c'est-à-dire par une remontée de nappe - les zones de résurgence situées dans le versant (" mouillères ") où la présence en surface de la nappe est due à la proximité de la roche mère ou à la présence d'horizons imperméables peu profonds Ceci se traduit par la présence dans le paysage de zones engorgées en eau, avec la présence possible de flaques. Ces zones sont à distinguer de la présence d'eau due à une semelle de labour. Dans les autres parties du versant, la nappe est généralement située à plusieurs mètres de profondeur. Enfin, au cours d’une averse, lorsque le sol est déjà saturé en eau, une partie des précipitations infiltrées chemine quasi horizontalement dans les couches supérieures du sol pour réapparaître à l'air libre, à la rencontre d'un chenal d'écoulement (par exemple, un fossé, un drain). Cette eau qui peut contribuer rapidement au gonflement de la crue est désignée sous le terme d'écoulement de subsurface (aussi appelé, dans le passé, écoulement hypodermique ou retardé). L'importance de cette partie des précipitations infiltrées et transférées horizontalement dépend essentiellement de la structure du sol. Elle est favorisée par la présence d'une couche relativement imperméable à faible profondeur. Cet écoulement qui peut être important tend à ralentir le cheminement de l'eau et allonge la durée de la crue. |
|
|
2- Réactivité de la nappe aux pluies : l’influence de la porosité du milieu |
|
La nappe est très réactive aux pluies : elle peut monter de plusieurs centimètres en quelques heures en hiver lorsque le cumul des pluies est important. A l'échelle de l'année, la profondeur de la nappe peut varier de plusieurs mètres entre le mois de janvier et l'été. Cette réactivité à la pluie dépend de la porosité de drainage du sol et de l'altérite (c'est à dire le nombre et la taille des espaces par laquelle elle peut circuler). Elle dépend de la nature de la roche mère mais aussi du degré d'altération de la roche. Elle peut donc varier selon le bassin versant considéré et sur un même bassin entre l'aval et l'amont, comme cela a été estimé sur deux petits bassins versants sur granite (figure 7). |
|
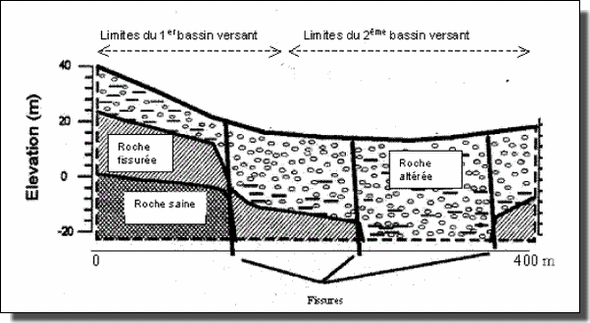 |
|
Figure 7 :
: Interprétation de l'épaisseur de l'altérite sur deux petits bassins versants granitiques finistériens (D'après Legchenko et al., 2003, extrait de Martin, 2003, interprétation par Résonance Magnétique Protonique et résistivité électrique).
|
|
|
3- Estimer la vitesse des écoulements dans la nappe |
|
Les écoulements dans la nappe sont déterminés par la différence de charge entre deux points. Ainsi la mise en charge de la nappe en hiver par les pluies entraîne la formation d'un gradient hydraulique entre l'amont et l'aval (figure 10). Le gradient hydraulique correspond à la pente de la surface de la nappe. Plus ce gradient hydraulique est fort, plus la dynamique d'écoulement des eaux sera rapide. La vitesse de circulation de l’eau dans la nappe dépend donc : - de la porosité de drainage. Ce paramètre n'évolue pas au cours du temps, il dépend de la roche mère et de son degré d'altération. - de l'intensité du gradient hydraulique. Comme la surface de la nappe est grosso modo parallèle à la surface du sol, le gradient est souvent assimilé à la pente topographique en première approximation. Les zones de pente élevée ont donc des gradients hydrauliques forts comparés aux zones de plateaux : l'eau y circule donc plus rapidement. - du cumul de pluies qui augmente le gradient hydraulique. Au sein d'un même bassin, les écoulements dans la nappe seront donc plus ou moins rapides selon la partie de la nappe considérée et les saisons. |
|
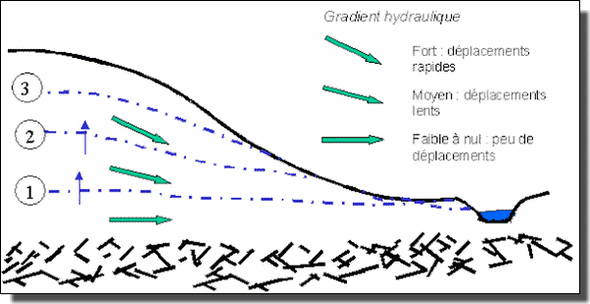 |
|
|
Figure 8
: Variations des hauteurs de la nappe au cours de l’année du fait de sa
forte réactivité aux pluies et, en conséquence, des gradients hydrauliques
à mi versant (flèches pleines vertes). 1 - Niveau minimum d’été, gradient faible 2- Niveau intermédiaire plus ou moins haut selon le cumul des pluies (automne-hiver), gradient en augmentation 3- Niveau de fin d’hiver (maximum), gradient fort. |
|
|
4- Stratification chimique de la nappe |
|
Du fait des caractéristiques différentes des écoulements au sein de la nappe (affleurement ou non dans les horizons supérieurs du sol, vitesse plus ou moins rapides des écoulements …), la nappe présente souvent une composition chimique différente en surface et en profondeur : elle est stratifiée. On distingue en général 2 zones : - La nappe en surface (jusqu'à 10-15 mètres de profondeur), appelée aussi nappe d'altérite. Lorsque ce réservoir est en forte charge hydraulique (hiver), il contribue fortement au débit de la rivière. Sur le bassin versant de Naizin (56), les concentrations en nitrates y sont stables et fortes de l'ordre de 80 mg/l (soit environ 2 fois la concentration mesurée dans la rivière) avec des pointes à 200 mg/l. - La nappe en profondeur, située à plusieurs dizaines de mètres. Elle est plus ou moins chargée en nitrates selon l'historique agricole du bassin versant mais aussi des possibilités d'épuration qui peuvent s'y produire (dénitrification autotrophe par la pyrite (voir le chapitre 'Evaluation scientifique des fonctions assurant la protection de la ressource en eau')). |
|
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|