 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |
Vous êtes ici :
|
|||||||||||
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
||||||||||||
|
Fonctions |
||||||||||||
| N. Carluer et C. Gascuel |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
La figure ci-dessous illustre les principales
fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur
sont associés.
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Figure 8 :
Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) |
||||||||||||
Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). |
||||||||||||
|
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules |
||||||||||||
La fonction de collecte se produit
lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le
fossé. C’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On
peut isoler 3 types de voie de transfert de l’eau provenant d’une parcelle
vers le fossé :
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des distances, indifférence) dans la procédure de traitement, - par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent donc des polluants de nature différente. - par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface. L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de collecte si : - il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, - s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, - si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un contexte pédoclimatique proche du contexte breton. Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu. Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés. Dans le cas d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de la parcelle vers le fossé. |
||||||||||||
|
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle |
||||||||||||
La fonction de
transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule
sous l’effet de la pente et transite vers l’aval du bassin versant.
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type d’écoulement qui se produit dans le fossé : - à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, - à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). |
||||||||||||
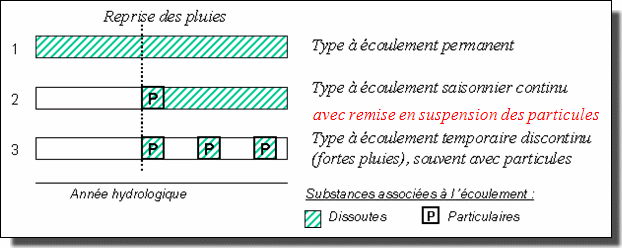 Figure 9 : Typologie
des écoulements possibles dans un fossé
|
||||||||||||
L’écoulement est également caractérisé
par : - sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et du fond du fossé), - sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré. Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement» des réseaux d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires |
||||||||||||
La rétention des
produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des
polluants et évite (ou retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle
de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une première approche
que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées
(processus pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais
souvent partiel).
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton (schiste, climat océanique tempéré). Cette étude montre que : - la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs. - Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc importante. - Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique vraisemblablement ce phénomène. - Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus faible. - La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les substrats que l’on peut rencontrer. - Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol,
sous le fossé, est faible puisque aucune trace de molécules n’est repérée
à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même
manière, la concentration en pesticides de l’eau juste en dessous de la
surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau
circulant librement dans le fossé.
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus élevées indiquent une rugosité faible. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification |
||||||||||||
La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été
étudiée sur des fossés situés dans des zones humides où la nappe est
donc proche de la surface. |
||||||||||||
|
3 En France, il est d'usage de
distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de
l'Hydraulique Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole
regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-agricole effectués à
l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau.
L’assainissement agricole rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble
des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004.
|
||||||||||||
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|