 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |
Vous êtes ici :
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Délimitation fossés |
||||||||||||||||||||||||||||
| N. Carluer et C. Gascuel |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1- Le fossé |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes (fonction de collecte).
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain.
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième aspect est peu quantifié. Le fossé peut : - accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les fossés de transfert, - ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce sont les fossés de collecte, - modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes). Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : - à l’intérieur d’une parcelle, - entre un champ et une route, - à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes (figure 5). |
||||||||||||||||||||||||||||
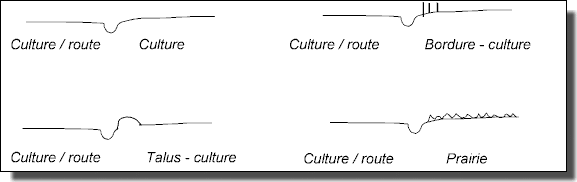 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 5 : Les
différentes bordures de fossés. Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : - le gabarit du fossé (forme et dimensions), - la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, - la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …). |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour étudier et prendre en compte la diversité de
situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en sous-unités
homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une
caractéristique (limite de parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau,
présence d'une haie…). La figure 6 montre le type de segmentation que l’on
peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de
constrictions des écoulements est cependant très peu étudié.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Figure 6 : Segmentation du réseau
de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2- Le réseau de fossés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui
y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers les points bas
du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de
fossés dans un bassin versant modifie donc les échanges entre la surface
et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins
important selon ses caractéristiques.
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
a- Les fossés de voirie |
||||||||||||||||||||||||||||
Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie
aient une place importante. Une étude réalisée sur le Stérenn, sous bassin
versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire
total de fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de
1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 2003). |
||||||||||||||||||||||||||||
|
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Les drains d’une parcelle
débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est
donc une continuation visible du réseau de drainage enterré.
Le drainage agricole est l’ensemble des
opérations accélérant l’élimination des excès
d’eau au sein d’une
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques
dizaines de centimètres et d’évacuer des événements pluviométriques
de l’ordre de 1 à 2 l.s-1.ha-1
en quelques jours (Merot et al., 2004).
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 7 :
Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de
transferts. |
||||||||||||||||||||||||||||
Les
opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du
réseau de fossés, entraînant une augmentation des vitesses de transfert
dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration,
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en
transit.
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir
à des modes d'évacuation moins rapides permettant une limitation du
transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des
écoulements ou une diversification des vitesses de transfert à chaque
étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement
dynamique".
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3- Critères de description |
||||||||||||||||||||||||||||
|
a- Critères descriptifs des fossés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
b- Critères d'environnement immédiat |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
c- Critères descriptifs du réseau de fossés |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole |
||||||||||||||||||||||||||||
Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
a- Les paramètres de terrain |
||||||||||||||||||||||||||||
Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres.
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. On y trouve notamment : - L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; - La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; - La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention des flux. Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : - Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; - Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du fond du lit du fossé, l'ensoleillement … Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de la nature des polluants. Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des sols, occupation du sol, cadastre…). Tableau 1 : Exemple de grille terrain |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires |
||||||||||||||||||||||||||||
Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces paramètres.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|