 |
|
|
MENU
PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau . Produits phyto. . Nitrates . Phosphore . Mat. organique dissoute . Métaux lourds . Bactéries . Conclusion . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Voies de transfert . Infiltration . Ruissellement . Ecoulement de nappe . Vitesse de transfert . Temps de transfert . Conclusion . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau • Zones humides • Bandes enherbées • Bordures de champs • Analyse du paysage Liens |
Vous êtes ici :
|
||||||||||||
|
Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017
|
|||||||||||||
|
Les voies de transfert : Circulations de l’eau et des polluants dans les bassins versants sur socle |
|||||||||||||
| J. Molénat, J.M. Dorioz, C. Gascuel et G. Gruau |
|||||||||||||
|
III- Ruissellement et érosions |
|||||||||||||
Le ruissellement est l’écoulement de l’eau à la surface du sol. Il s’accompagne de transport de matières à l’état dissous ou particulaire (érosion). Parce que les effets du ruissellement sont souvent visibles (formation de rigoles, de ravines, déplacements de terre), c’est un processus que s’approprient facilement les agriculteurs. Pourtant, il ne participe qu’à quelques pour cent du bilan annuel des écoulements car il n’intervient qu’au cours de quelques averses par an ou sur certaines parties du bassin versant où la nappe affleure. Il existe deux types de ruissellement : - par dépassement de la capacité d’infiltration du sol - sur surface saturée. |
|||||||||||||
|
1- Le ruissellement par dépassement de la capacité d’infiltration |
|||||||||||||
Le ruissellement par dépassement de la capacité d’infiltration ou hortonien survient lorsque l’intensité de pluie (P en mm/h) est supérieure à la capacité d’infiltration instantanée du sol (IC en mm/h) en surface. L’infiltration de la pluie devient alors très faible. Ce ruissellement est à la fois fonction de la pluie, de l’état structural du sol et de son humidité. Il est variable dans le temps et l’espace. Compte tenu des propriétés hydrodynamiques des sols et des intensités de pluie rencontrées en Bretagne, le ruissellement par dépassement de la capacité d’infiltration se produit seulement pour quelques averses par an (environ une à deux par mois pour la région de Rennes dont les sols sont à faible stabilité structurale). Il est notamment favorisé sur les sols nus où la formation d’une croûte de battance apparaît plus facilement (figure 6). Il peut également apparaître très localement dans les traces laissées par les engins agricoles qui compactent le sol. |
|||||||||||||
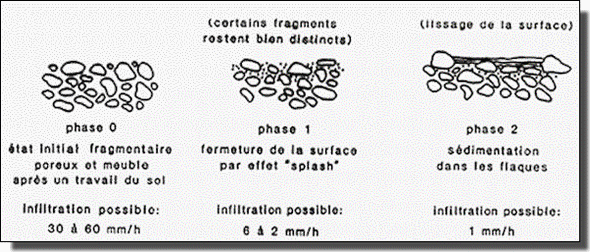 |
|||||||||||||
Figure 6 : Développement d’une croûte
de battance à la surface du sol sous l’effet de la pluie. Extrait de Cosandey, 1990, d’après les travaux de J. Boiffin. |
|||||||||||||
Les cumuls horaires des pluies ne permettent pas d’appréhender les phénomènes de ruissellement car l’intensité des averses varient sur un pas de temps plus court : le ruissellement est souvent déclenché sur quelques minutes voir quelques dizaines de minutes. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2- Le ruissellement sur sols saturés |
|||||||||||||
Il est aussi appelé ruissellement de zone
contributive ou ruissellement de source à surface variable.
Il se produit lorsque le sol est gorgé d’eau (porosité remplie d’eau). La capacité du sol à stocker une quantité plus importante d’eau est dépassée: le sol "déborde". C’est le cas à la suite d’une remontée ou émergence de nappe. Contrairement au ruissellement hortonien, la genèse de ce ruissellement est indépendante de l’intensité des pluies : elle dépend du cumul de pluie et des conditions du milieu. Ce processus se produit dans les zones à nappes superficielles comme les massifs anciens (Massif Armoricain, Massif Central). Les surfaces saturées se développent notamment dans les zones de bas fond et concernent plus rarement les zones de plateaux où les sols sont généralement bien drainés. Les surfaces saturées se forment en hiver, lors de la remontée de nappe, au cours des averses et se contractent ensuite. Les sols présentant à un niveau ou à un autre un horizon imperméable (semelle de labour) génèrent aussi ce type de ruissellement puisqu’ils sont plus rapidement saturés en eau. |
|||||||||||||
|
3- Ruissellement, érosion hydrique et sédimentation |
|||||||||||||
L’érosion hydrique est un phénomène résultant de plusieurs processus qui se distinguent notamment par le caractère diffus ou concentré des départs de terre. L’érosion est diffuse lorsqu’elle s’opère sur l’ensemble de la surface, que la pente est faible (< 3 %) et que la force du ruissellement n’est pas suffisante pour arracher des particules de terre au sol de manière importante. Elle devient concentrée lorsque le ruissellement est lui même concentré provoquant la formation de rigoles et de ravinement, notamment lors de pluies orageuses et dans les zones de collecte des eaux (talweg dans une grande parcelle de sol nu). L’érosion des terres en Bretagne existe bien qu’elle soit en général diffuse et peu perceptible. Les pertes en terres cumulées peuvent être évaluées à 300 kg/ha/an pour une culture de maïs (Cros Cayot, 1996), quelques kg à quelques centaines de kg sur des petits bassins versants (Lefrançois, 2007). Al’échelle locale, l’érosion des berges, la connectivité des parcelles par les chemins, importante dans les secteurs d’élevage, peut jouer un rôle déterminant sur ce bilan. A l’échelle régionale, la faible teneur en matière organique du sol, donc sa faible stabilité structurale des sols est un facteur important. Cette érosion est très variable d’une année à l’autre, liée à la saisonnalité (érosion hivernale sur sol saturés) et à la présence d’évènements majeurs (érosion de printemps liée à des cultures recouvrant très peu le sol). La sédimentation des particules se produit au contraire lorsque la vitesse du ruissellement n’est plus suffisante pour maintenir les particules en mouvement. A une même vitesse d’écoulement, les limons se déposent en premier alors que la sédimentation sera plus longue pour les argiles. Cette sédimentation agit à toute les échelles, depuis le versant, jusqu’à la sédimentation à l’intérieur même du cours d’eau. |
|||||||||||||
|
4- L’exfiltration |
|||||||||||||
Il y a exfiltration quand le sol n’a plus la capacité de transmettre tout le flux de nappe. Une partie de la nappe s’écoule alors à la surface. Elle survient notamment dans les talwegs concaves. Pendant les périodes humides, du fait de la remontée de la nappe, on observe une extension progressive de cette zone d’émergence. Exfiltration et ruissellement sur zone saturée sont réunis sous le nom d’écoulement de zone contributive. |
|||||||||||||
|
Conclusion |
|||||||||||||
Ces
mécanismes font que la relation entre la pluie et le débit est : - non proportionnelle (stockage possible d’eau lié à des circulations souterraines, restitution par évapotranspiration), - variable d’une crue à l’autre, d’une saison à l’autre, d’une année à l’autre, pour un même bassin versant, - variable d’un bassin versant à un autre selon les conditions géologiques, pédologiques, climatiques et selon l’occupation du sol. |
|||||||||||||
|
Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |
||
| 0 visiteurs uniques à ce jour |
|
|